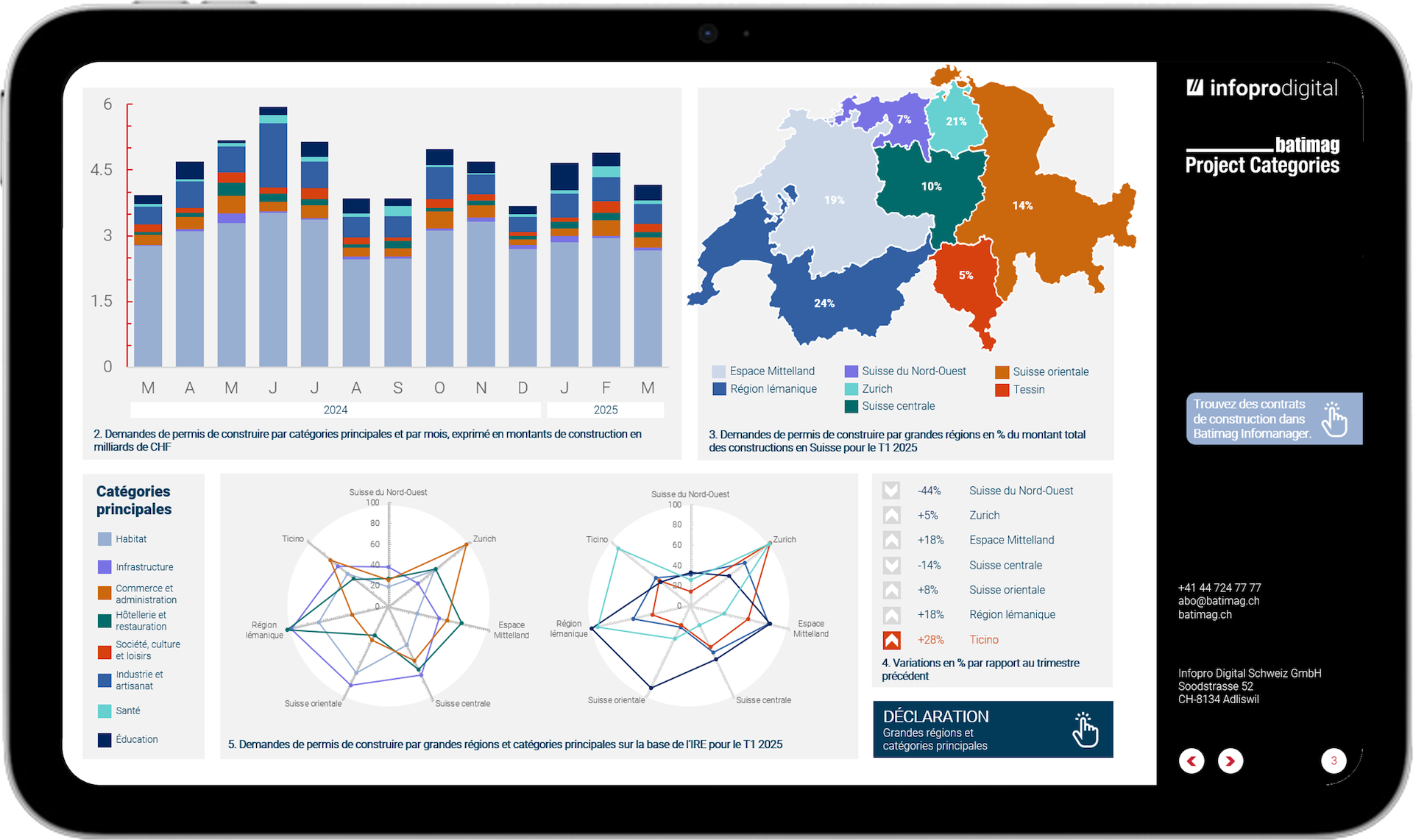Le chêne d’Ajoie supplante l’acier pour moderniser un beffroi
C’est un choix patrimonial que la commune neuchâteloise de Saint-Blaise a dû faire pour moderniser son temple envahi par l’humidité. Et elle a tranché pour le bois. En effet, l’acier de la structure soutenant les cloches depuis 1949 a été remplacé par une poutraison en chêne d’Ajoie. Et pour mieux laisser respirer les murs, les architectes ont privilégié un crépi de chaux hydraulique.

Crédit image: Philippe Chopard
L’enveloppe souffrait de graves problèmes hygrométriques, ce qui a nécessité un assainissement complet, avec, notamment, le remplacement de l’enrobé coulé à la base des façades.
Les exigences d’une restauration patrimoniale réussie ne vont pas forcément de pair avec l’évolution des prix de la construction. Mais la volonté de restituer au temple de Saint-Blaise son aspect d’origine a prévalu dans la commune neuchâteloise, malgré un coût d’assainissement légèrement plus cher. Notamment pour remplacer le beffroi d’acier créé en 1949 par une structure en chêne.
En 2004 déjà, un architecte de ce village à l’allure patricienne signalait des problèmes hygrométriques importants sur ce lieu de culte réformé souvent choisi pour des concerts. Les travaux de restauration entrepris en 1949 par la paroisse du lieu avaient en effet ravalé les façades avec des revêtements qui ne les laissaient pas respirer. Les infiltrations constatées depuis la base du bâtiment laissaient craindre une dégradation irrémédiable de sa structure. A l’époque, la commune avait simplement pris acte de la situation. Il a fallu encore plus de dix ans avant qu’elle ne lance un appel d’offres pour une réhabilitation d’envergure, finalement remporté en 2018 par le bureau d’architectes MSBR Nouvelle Génération, de La Chaux-de-Fonds (NE). Outre les problèmes d’humidité, se posait aussi la question du maintien du beffroi en acier. L’Office cantonal neuchâtelois du patrimoine et d’archéologie (Opan) ne voyait pas sa conservation d’un très bon œil. Installé en 1949, à une époque où le temple n’était pas encore classé – il l’a été en 1963 – , le beffroi n’était pas compatible avec une restauration digne de ce nom. « Nous l’avons démonté pour le transporter dans un atelier spécialisé en Argovie, explique Silas Liechti, architecte au bureau MSBR. La structure était composée d’environ 900 rivets qui ne pouvaient plus assurer sa solidité. C’est donc son état qui a dicté sa transformation, en plus des exigences patrimoniales. »

Crédit image: MSBR Nouvelle Génération SA-Silas Liechti
La nouvelle structure de bois supportant les cloches a été montée par autogrue.
Dès lors, le bois a repris ses lettres de noblesse dans la tour du temple. Les travaux ont préservé l’assemblage charpenté datant du XVIe siècle. Un renforcement sur les trois niveaux de la tour par de nouvelles poutres a cependant été nécessaire. Réalisé par l’entreprise Tschäppät & Moret SA et le bureau d’ingénieurs-conseil dnm de Saignelégier (JU) avec divers travaux de consolidation de la charpente, le nouveau beffroi du temple est donc composé de poutres en chêne d’Ajoie. Ses éléments sont parvenus au sommet de la tour par autogrue pour être assemblés sur place, malgré l’exiguïté des lieux. Il a fallu pour cela recourir au savoir-faire compagnonnique de Joseph Guillemeau, dans le plus grand respect de son cachet patrimonial. Ce dernier est intervenu selon la méthode dite « à la casquette », c’est-à-dire par petites touches.
Comme
Notre-Dame de Paris
Les techniques employées ici sont similaires à celles utilisées par les
restaurateurs de la charpente de Notre-Dame de Paris. Les trois cloches ont été
déposées pour être nettoyées. Autrefois alignées, elles ont ensuite été
suspendues sur deux niveaux. Leur sonnerie automatisée a été modernisée. Le
faîte de la tour, avec sa flèche et son coq, a enfin été restauré.

Crédit image: MSBR Nouvelle Génération SA-Silas Liechti
L'assemblage de la structure porteuse des cloches s’est déroulé dans un espace très étroit et sous la haute surveillance d’un expert compagnon.
« Avec ce beffroi en bois, nous devons tenir compte de plusieurs nouveaux paramètres, poursuit Silas Liechti. L’acier était trop fixe. La nouvelle structure bouge au gré de plusieurs phénomènes statiques, et cela peut influencer le son des cloches. »
La restauration s’est aussi attaquée aux combles de la nef. La charpente historique, encore en bon état, a pu être préservée. Le sol a été isolé et renforcé. L’occasion de constater que le moyen-âge et la Renaissance construisaient solidement et durablement ! A l’intérieur, des travaux de nettoyage et de pose d’un nouveau chauffage par ventilo-convecteurs a permis à la nef d’être plus accueillante, tout en gardant ses atouts architecturaux. A terme, le temple sera chauffé à distance depuis la raffinerie de Cressier, vu que le canton de Neuchâtel a annoncé l’interdiction des systèmes électriques d’ici 2030. Temporairement, le chauffage est encore assuré par le mazout. Les installations techniques ont pu élire domicile dans une nouvelle armoire pour se faire plus discrètes.
Un enrobé pour
du gravier
Le second objectif de cette restauration a été de résoudre durablement les
problèmes d’humidité constatés en 2004. Il a fallu remplacer l’enrobé du pied
des façades de l’édifice par un revêtement en partie en gravier, pour éloigner
l’eau qui s’insinuait dans la structure du bâtiment. Du côté est, le crépi posé
en 1949 s’est révélé trop étouffant. « Nous l’avons remplacé par un enduit fait
de chaux hydraulique pour mieux faire respirer le mur », indique Silas Liechti.
La toiture a aussi été munie de cheneaux pour mieux évaluer les eaux pluviales.

Crédit image: Philippe Chopard
Le parvis a été réaménagé et l’entrée principale modifiée, dans le strict respect du cachet patrimonial du bâtiment.
L’enrobé en béton du parvis a également été remplacé par un revêtement plus en phase avec celui du centre de la localité, avec pavés et gravier, et par un nouveau mobilier urbain plus accueillant. Quant à l’auvent situé au-dessus de l’entrée du temple, il a pu être reposé… après plus d’un siècle d’absence. Le sas d’accès à la nef a aussi été modernisé. L’esplanade accueille désormais quatre nouveaux arbres et son mur de soutènement a été reconstruit.
Le temple de Saint-Blaise a été érigé en grande partie vers les années 1500, avec des mentions initiales de son existence au Xe siècle déjà. Sa récente restauration a permis aux archéologues de trouver de nombreuses sépultures anciennes. La planification du chantier sur trois ans, dont deux sans interruption de son activité culturelle, ainsi que son coût – près de 3 millions – ont été respectés.