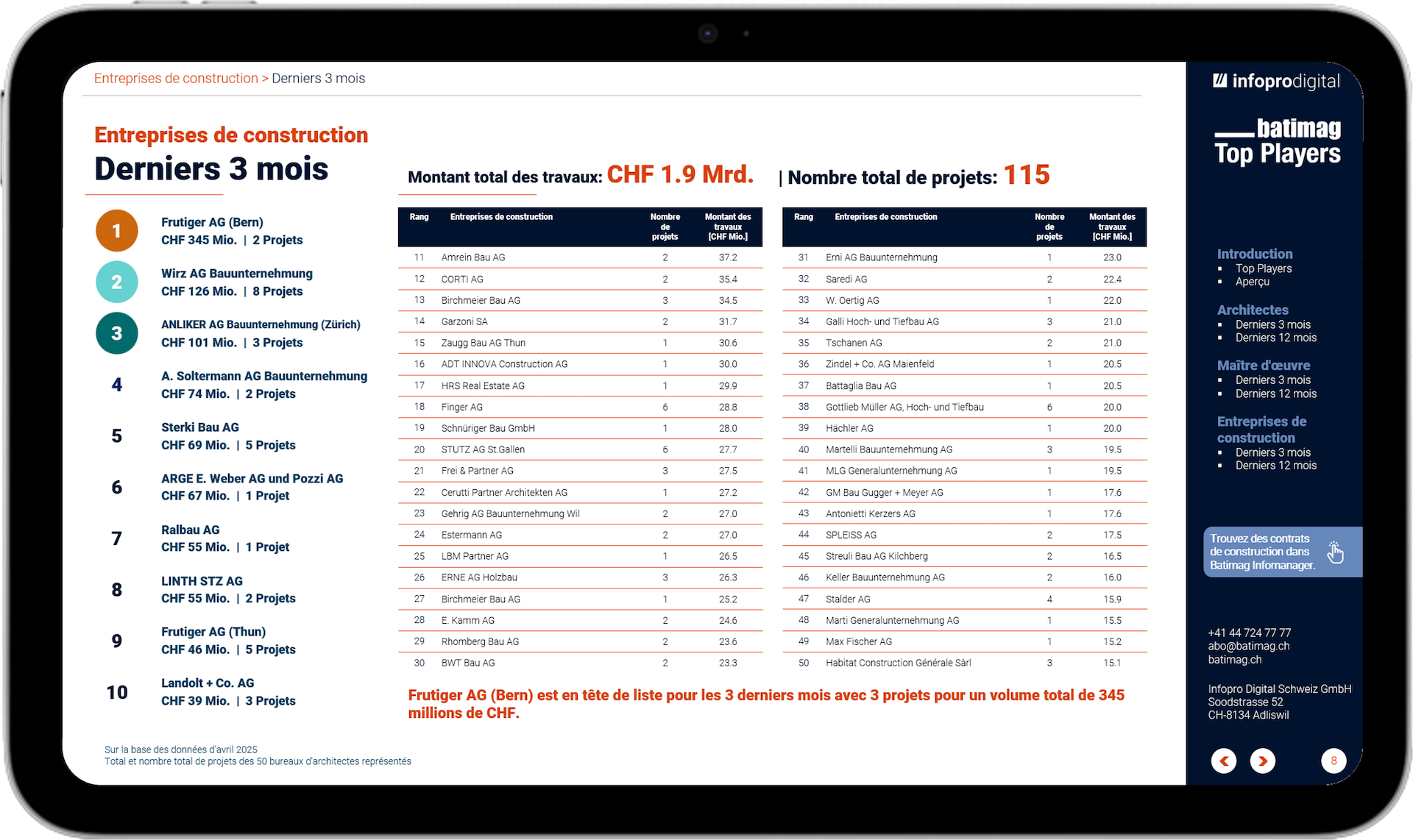Le système hydraulique romain d’Arles révélé par ses dépôts de carbonate
L’analyse des dépôts calcaires présents dans les aqueducs, canalisations et bassins romains permet de reconstituer l’évolution du système d’approvisionnement en eau d’Arles depuis l’Antiquité. Une étude internationale révèle une remarquable capacité d’adaptation.

Crédit image: Cees Passchier
La découverte de dépôts de carbonate dans les blocs effondrés des thermes d’Arles a permis de mettre au jour la trace d’un aqueduc romain oublié.
Il y a environ 2000 ans, l’approvisionnement en eau de la ville romaine d’Arles reposait sur un réseau complexe d’aqueducs, de bassins et de conduites, soigneusement entretenu et adapté aux besoins de la population au fil des siècles. Une étude menée par une équipe germano-autrichienne-britannique a analysé les dépôts calcaires - ou carbonates - retrouvés dans ces infrastructures antiques et reconstitué le fonctionnement de ce réseau. Il s'agit donc de l'un des exemples les plus évidents d'un système de gestion durable de l'eau dans l'Antiquité, ont conclu les chercheurs.
Contrairement aux études précédentes, qui portaient généralement sur un seul aqueduc, la présente étude examine l'approvisionnement en eau d'Arles dans son ensemble. Certains liens entre différents éléments du système d'approvisionnement en eau de la ville étaient déjà soupçonnés depuis longtemps, mais l'étude a pu les confirmer et prouver la longue durée de vie de l'aqueduc romain d'Arles.
Du massif des
Alpilles à Arles
Il y a un peu plus de 2000 ans, un aqueduc provenant du versant sud du massif
des Alpilles alimentait Arles en eau. Près de cent ans plus tard, une autre
amenée a été construite à partir du versant nord de ces mêmes collines, dont
l'eau se jetait avec celle de son homologue sud dans un bassin existant de
l'aqueduc d'origine. Avec la mise en service de l'aqueduc nord, celui du sud a
reçu une nouvelle fonction : il a été détourné et son eau alimentait désormais
un immense complexe de moulins à eau à 16 roues situé dans le Barbegal voisin.
Cela avait toutefois déjà été confirmé par une étude antérieure, également
basée sur des analyses de carbonates.

Crédit image: Cees Passchier
Au premier plan des thermes romains d’Arles, on distingue des blocs issus de l’effondrement du plafond. Ceux-ci contenaient des dépôts carbonatés révélateurs.
L'équipe a également découvert que le bassin servait à l'origine de bassin de collecte devant un pont-aqueduc à arcades. Ces bassins permettaient au sable et aux autres matières en suspension de se déposer et l'aqueduc nord a été ajouté plus tard de manière improvisée. Les archéologues l'ont compris en constatant que les vestiges architecturaux débouchaient dans le bassin à un point plus élevé. Des fragments du plafond effondré des thermes de Constantin ont apporté un nouvel indice: « Nous avons également trouvé des carbonates d'aqueduc dans ces fragments de plafond effondrés de l'aqueduc nord », expliquent-ils. « Apparemment, l'aqueduc a été restauré sur ordre de l'empereur Constantin lors de la construction des thermes au début du IVe siècle, et les carbonates écaillés ont été utilisés comme matériau de construction pour le toit des thermes. » Les scientifiques ont ainsi pu répondre à la question de savoir d'où venait l'eau des bains et jusqu'à quand l'aqueduc romain a été en service. Ce dernier a fonctionné au moins jusqu'à la construction des thermes, car les carbonates extraits de l'aqueduc ont été utilisés pour leur construction. L'aqueduc a probablement été en service jusqu'au Ve siècle, jusqu'à l'arrivée des Francs et des Burgondes.
La fonction des grands tuyaux romains en plomb découverts au XIXe siècle, qui traversaient le lit du Rhône, n'était pas claire non plus: après avoir constaté qu'ils contenaient des dépôts présentant une composition isotopique similaire à celle des aqueducs des bras nord et sud, cela a confirmé qu'un siphon inversé de l'aqueduc d'Arles alimentait le quartier opposé de Trinquetaille.
Quand l'aqueduc
est aussi une archive
« Sans les dépôts carbonatés de l'aqueduc, il serait impossible de reconstituer
ces liens », explique un membre de l'Institut des sciences de la Terre de
l'université Johannes Gutenberg. Cependant, comme les sédiments sont fortement
contaminés par de l'argile, il est impossible de les dater à l'aide des
méthodes traditionnelles. « Nous avons donc analysé les isotopes stables
d'oxygène et de carbone présents dans les carbonates et corrélé les profils
isotopiques afin de déterminer les dates de leur dépôt simultané », expliquent
encore les chercheurs. « Cela nous a permis d'identifier les mêmes couches
annuelles dans les carbonates et ainsi de déterminer leurs périodes de dépôt
relatives et donc le moment historique des transformations et des modifications
du système d'approvisionnement en eau d'Arles. »