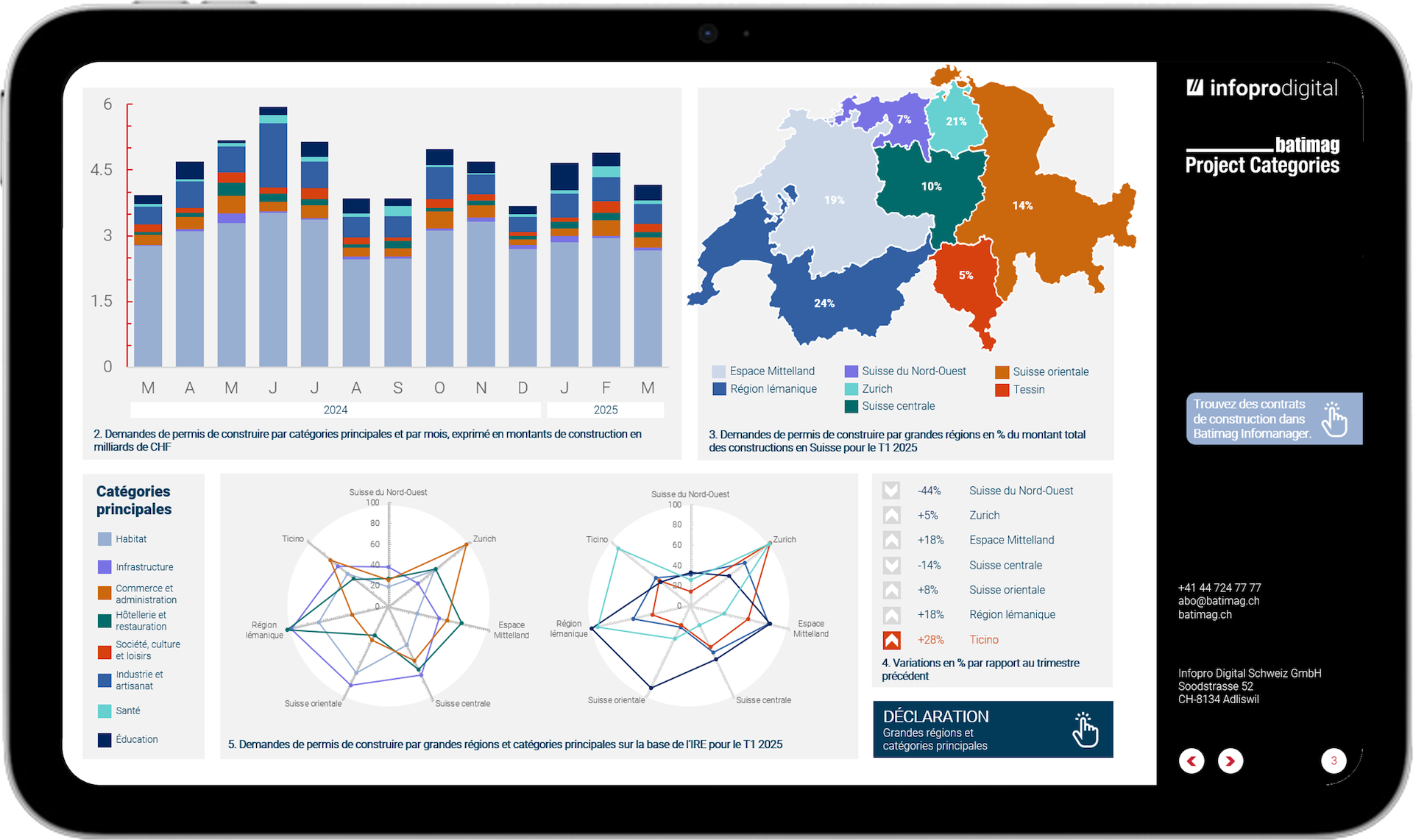Le viaduc de la Baye de Clarens finalement sauvé de la démolition
Le viaduc sur la Baye de Clarens (VD) revêt une importance capitale pour les compagnies de chemin de fer régionales. Mais voilà, il a bien failli disparaître à tout jamais, emporté par un glissement de terrain insidieux qui le menace depuis des décennies. Pour des questions de coût, le maître d‘ouvrage ne se voyait pas reconstruire un nouveau pont. Finalement, la solution est venue des… Grisons. Grâce notamment à des appuis glissants et une auge en béton armé précontraint, l’ouvrage d’art va désormais accompagner la progression du terrain. Et sera réajusté tous les 15 à 25 ans !

Crédit image: Swiss-fly Boris Bron
Le viaduc surplombe la Baye de Clarens à environ 25 m au-dessus du fond du ruisseau. Les équipes engagées sur ce chantier ont été confrontées à des conditions de travail particulièrement exigeantes et dangereuses dans cet environnement sauvage et escarpé.
Il y a des ouvrages d’art discrets et méconnus qui revêtent une importance capitale. C’est le cas du viaduc de la Baye de Clarens situé sur les hauteurs de la Riviera vaudoise. Ce pont ferroviaire, emprunté épisodiquement par les trains historiques du Chemin de fer Musée Blonay – Chamby, est également essentiel pour les MVR (Transports Montreux – Vevey – Riviera SA) et le MOB (Compagnie du Chemin de fer Montreux Oberland bernois SA). En effet, l’ouvrage en maçonnerie de pierres naturelles, construit en 1902, relie les réseaux ferroviaires du MOB et de la ligne Vevey – Blonay – Les Pléiades du réseau MVR.
Cette ligne est ainsi un véritable trait d’union entre les deux réseaux. Elle permet de faire transiter le matériel roulant en fonction de la demande. Ce lien permet des synergies et des économies de matériel ferroviaire importantes : grâce au viaduc de la Baye de Clarens, le matériel roulant voyageur peut être transféré selon les besoins du moment, qu’il s’agisse de renforcer les Pléiades pour le ski ou les narcisses ou au contraire le trafic pendulaire entre Montreux et Château-d’Oex. Côté infrastructure, une flotte unique permet l’entretien des installations des MVR et du MOB. Sans ce pont, il faudrait augmenter le parc de matériel pour pouvoir exploiter les deux réseaux.

Crédit image: Jean-A. Luque
Spectaculaire! Le pied de la pile P1a été détaché de ses fondations afin que les futures déformations de la pente puissent se dérouler sans trop affecter la structure porteuse.
Le problème, c’est que ce viaduc a bien failli disparaître à tout jamais, emporté par le terrain sur lequel il est posé. Un glissement de terrain insidieux – de la roche altérée située sous le rocher dans lequel les piliers ont été fondés – menace depuis sa construction la partie ouest de l'ouvrage d'art historique, soit la partie du pont appuyée sur la rive droite de la Baye de Clarens.
Glissement de
terrain profond
« Dès 2003, confie Yves Pittet, membre de la direction du MOB et responsable
Infrastructure, le suivi de l’ouvrage montrait que nous nous trouvions en
présence de déformations particulières, une des arches se resserrait. Nous
avons mené des investigations géologiques et géotechniques, entrepris des
forages verticaux pour comprendre ce qui pouvait bien provoquer ces dégâts.
Mais, à cette époque, nous n’avons rien mesuré de particulier, il nous a fallu
de nombreuses investigations complémentaires avant de découvrir que le
glissement avait lieu sur des sols bien plus profonds, à 45 mètres sous les
rails. »
En 2009, les investigations s’amplifient et les ingénieurs mandatés émettent un constat sans équivoque : à terme, le viaduc est condamné. Les deux premières voûtes, côté Blonay, ainsi que les éléments de construction adjacents, à savoir la culée Blonay et la pile 1, sont les plus endommagés.
« Nous avons lancé en 2015 un concours pour un nouveau pont, explique Yves Pittet. 33 projets nous sont parvenus ; le vainqueur proposait un ouvrage avec une seule pile, fondée sur le côté Montreux de la Baye qui n’est pas affectée par le glissement. Mais entre la procédure d’approbation des plans et l’appel d’offres aux entreprises, le devis a explosé : il est passé de 13,5 à plus de 20 millions de francs ! Pour l’Office fédéral des transports qui détient les cordons de la bourse, c’était exclu. Beaucoup trop cher ! »
Comment pérenniser alors cette ligne ? Toutes les options ont été étudiées. Changer de tracé avec un autre pont ou un tunnel ? Compliqué et encore plus onéreux. Finalement, après avoir prospecté auprès d’autres compagnies ferroviaires, la solution est venue des Grisons et des Chemins de fer rhétiques (RhB). Ils avaient déjà été confrontés en plusieurs endroits de leur réseau à pareil défi et, accompagnés d’un bureau d’ingénieurs, ils ont développé une solution aussi audacieuse qu’inédite mise en pratique avec succès sur quatre chantiers. Sur les deux dernières interventions, le bureau d’ingénieurs de Coire maîtrisant cette technique était intervenu.

Crédit image: Jean-A. Luque
Installés au pied de la pile, des appuis glissants permettent à l’ouvrage d’art d’accompagner le glissement du terrain.
L'idée consiste à séparer l’ouvrage du glissement de terrain, à remplacer les parties d’ouvrage trop affectées par les déformations et à rigidifier le tout au moyen d’une auge en béton armé précontraint reliant les deux culées. Cette auge est ancrée dans le côté stable du vallon et reprend les efforts principaux liés aux circulations ferroviaires. Pour que l’ouvrage supporte les déplacements du terrain – impossibles à arrêter – un dispositif de réglage permet de réajuster le pont au fur et à mesure de la progression du terrain. C’est là toute l’ingéniosité de la technique grisonne.
Technique
hypercomplexe
Sur place, les équipes des entreprises mandatées par les MVR ont déconstruit la
voûte n°1 et la culée côté Blonay pour les remplacer par une nouvelle
construction. L’ouvrage a également été prolongé d’une dizaine de mètres en
direction de Blonay, afin de déplacer la culée hors de la zone trop pentue. Une
nouvelle pile « 0 » a été construite à la place de l’ancienne culée et la
liaison avec le terrain au pied de la pile P1 a été supprimée en disposant des
appuis glissants. Désormais, les futurs mouvements du terrain peuvent avoir
lieu sans influence sur l'ouvrage. Par un jeu de précontrainte, la nouvelle
auge à ballast construite sur l’intégralité de l’ouvrage permet de compenser la
suppression de l’effet porteur de l’arche et d’assurer la sécurité structurale
de l'ouvrage.

Crédit image: Jean-A. Luque
L’auge à ballast du viaduc a désormais une importante fonction de support statique. Equipé avec 8 torons de précontrainte, le nouvel élément contribue de manière déterminante à la stabilisation des voûtes existantes.
« Reprendre le viaduc en sous-œuvre et en exploitation, c’est très particulier, techniquement hypercomplexe, assure Yves Pittet. L’ouvrage est cintré avec un rayon de 60 m. Le plan de glissement n’est pas unidirectionnel. Par exemple, l’auge en maçonnerie présentait une différence de hauteur d’une dizaine de centimètres entre l’intérieur et l’extérieur de la courbe. Il a fallu abattre la partie instable et séparer l’ouvrage du glissement avec des appuis glissants sur la culée, sur la nouvelle pile « 0 » et un dernier, le plus complexe à mettre en œuvre, sous la pile « 1 ». Le pont est lié au niveau de la culée par un clavetage et va suivre le glissement de terrain. Tous les 15 à 25 ans, en fonction de l’évolution réelle du glissement, un réajustement des appuis sera nécessaire. Lors de ce réglage, la pile 1 et l’auge seront soulevées à l’aide de vérins puis recalées en direction de l’amont. On pourra faire cela trois à quatre fois. » La flexion est possible en équipant l’auge à ballast avec 8 torons de précontrainte qui reportent tous les efforts vers le massif stable.
A couper le
souffle
Le 28 février dernier est sans aucun doute la date qui a marqué tous les
acteurs de ce chantier. C’est ce jour-là que l’arche problématique a été
démolie, l’instant-clé où la théorie et les calculs d’ingénieurs ont été
confrontés à la réalité. La précontrainte qui passait sur toutes les arches
allait-elle supporter la poussée au vide ? Le risque d’un effondrement n’était
pas exclu. Mais l’opération a été un succès, le viaduc en équilibre vibrait,
respirait… mais était plus solide que jamais.

Crédit image: Jean-A. Luque
Pendant le chantier, les échafaudages, tous posés sur console, ont été ancrés sur le viaduc en maçonnerie.
La méthode la plus judicieuse et la plus efficace pour réaliser les fondations de la culée Blonay et de la nouvelle pile a été l'utilisation de puits en béton. Quatre puits marocains d’un diamètre de 2,8 m et profonds de 6,7 et 5,3 m ont été réalisés par étapes de 1,4 m. Le préterrassement nécessaire a nécessité l'aide d'une protection de fouille conventionnelle composée de clous temporaires et d'une coque en béton projeté.
On s’en doute, dans cet environnement escarpé, le chantier a demandé une préparation importante et relevé de nombreux défis techniques. Les échafaudages, tous posés sur console, étaient ancrés sur le viaduc en maçonnerie. Il a également fallu une opération coup de poing de sept semaines où le trafic a été interrompu pour démolir la première arche et la maçonnerie, mettre à nu les voûtes puis débuter la construction de l’auge. A l’issue de ces sept semaines, la pose de 19 ponts provisoires a permis de reprendre la circulation sur la ligne tout en poursuivant les travaux.
La nouvelle auge à ballast en béton précontraint continu avec encorbellements latéraux sur toute la longueur du viaduc comprend également le drainage des eaux et une réalisation d’une étanchéité en couche mince. Dans un but de préservation du patrimoine, l’entier du mortier des joints des piliers et des faces latérales de l’ouvrage a été remis en état.
Le chantier
arrive à son terme. La fin des travaux est prévue pour avril 2025.