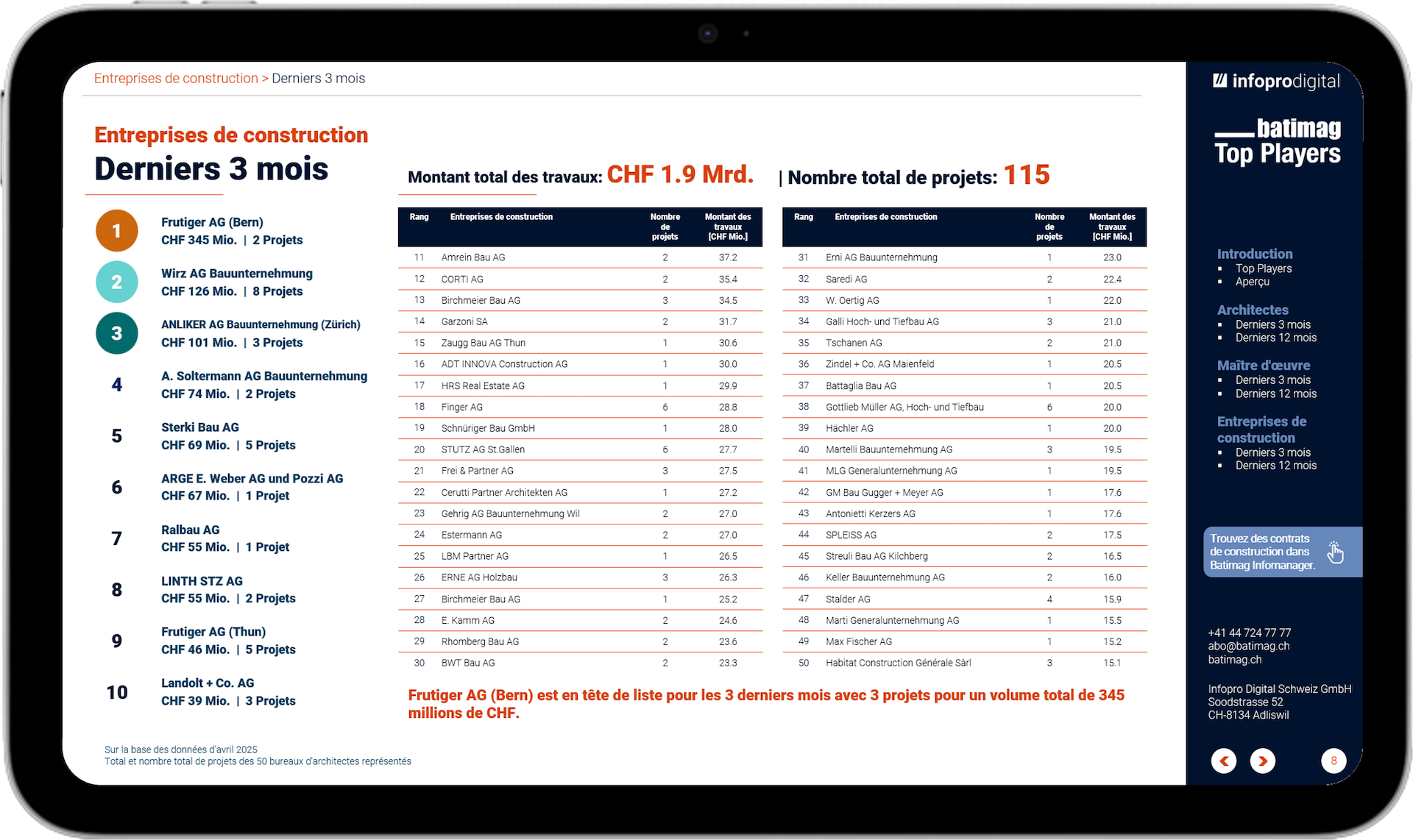Protection en bois contre les chutes de pierres: sur les traces des anciennes techniques de construction
Un projet de recherche de la Haute école spécialisée des
Grisons étudie les performances des anciennes palissades en bois en matière de
protection contre les chutes de pierres. Au moyen de tests de charge sur des
poutres en bois vieilles d'environ 30 ans, cette méthode de construction
ancestrale est examinée sous toutes les coutures.

Crédit image: DR
L’ouvrage de protection contre les chutes de pierres, composé d’éléments en bois près du Gruobenwald, à l’extérieur de Klosters, a été démonté pour être étudié en laboratoire.
Selon l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage
(WSL), 6 à 8% de la superficie de la Suisse sont concernés par un
sous-sol instable. Principalement dans les régions préalpines et alpines, des
glissements de terrain, des chutes de pierres ou des éboulements menacent. Ces
dangers naturels, dont la prévisibilité est souvent limitée, recèlent un énorme
potentiel de dommages en l'absence d'ouvrages de protection appropriés. Et le
risque que de tels événements augmente est inévitable en raison du changement climatique:
la fonte des glaciers et le dégel du permafrost libèrent les pierres et les
blocs de roche de leur «prison de glace».
Premières protections en bois
On était déjà conscient de cette menace au début des années 1900, par exemple
lors de la construction des Chemins de fer rhétiques de Landquart à Davos. Les
chutes de pierres représentaient alors, comme aujourd'hui, une menace
permanente pour de nombreux chemins de fer de montagne et habitations dans les
Grisons. A l'époque, les gens s'en prémunissaient avec les moyens les plus
simples, notamment les matériaux de construction disponibles. «Ils ont utilisé de
vieux rails de chemin de fer comme supports, ont creusé un trou et les ont bétonnés», explique James Glover, chef de projet scientifique sur les dangers naturels à
la Haute école spécialisée des Grisons à
Coire. Entre les piliers, on a placé des traverses de chemin de fer en bois de
chêne. C'est ainsi qu'est née la première protection contre les chutes de
pierres en bois.
Aujourd'hui, on trouve de nombreux types de construction
de telles barrières en bois. Avec différents types de poteaux, en bois rond ou
équarri. «Dans certains cas, le bois est directement assemblé les
uns aux autres pour former une protection complète», explique James Glover. D'autres
ouvrages de protection présentent en revanche des espaces ou des entretoises
entre les poutres et sont ancrés avec des rails de chemin de fer ou des poutres
HEM en acier. Dans la plupart des cas, les barrières en bois ont toutefois un
point commun: elles sont fondées de manière rigide.
Bois remplacé par des variantes modernes
Si ces palissades en bois étaient encore courantes autrefois contre les chutes
de pierres, on n'en construit pratiquement plus aujourd'hui. En effet, dans de
nombreux endroits, les ouvrages de protection traditionnels ont été remplacés
par des variantes plus modernes avec des filets en fil d'acier ou du béton.
Mais si l'on ouvre l'œil pour trouver les anciennes barrières en bois, on en
trouve encore dans le canton des Grisons, comme le souligne James Glover : «Le long
des anciennes voies de communication, des lignes de chemin de fer des Chemins
de fer rhétiques ou encore des chemins forestiers». Si l'on met bout à bout tous les ouvrages de protection
contre les chutes de pierres dans les Grisons, ils atteignent, selon le
chercheur, une longueur totale de 69 km, dont un tiers est toujours en bois.
.

Crédit image: DR
Une palissade en bois endommagée par l'abattage d'arbres près de Klosters. Beaucoup de ces constructions ont été réalisées dans les années 1990 et arrivent en fin de vie.
Les ouvrages de protection traditionnels ont été supplantés à partir des années 1960, par des filets en acier. «On a beaucoup investi dans la recherche et
le développement de ces filets», explique le chercheur. Au fil du temps, ils ont
ainsi pu être dimensionnés de manière à résister à des charges d'impact plus
élevées. Ces travaux n'ont toutefois pas concerné les anciennes palissades en
bois. C'est pourquoi on manque encore aujourd'hui de données fondamentales sur
le travail de rupture des poutres en bois soumises à des charges dynamiques de
chutes de pierres. De ce fait, mais aussi en raison de la domination de
l'industrie des filets en acier, l'utilisation d'éléments en bois dans les
ouvrages de protection contre les chutes de pierres est devenue
pratiquement obsolète.
Remplacer ou entretenir ?
Une grande partie des palissades en bois qui existent encore aujourd'hui dans
le canton des Grisons ont été construites dans les années 1990. James Glover : «En
moyenne, les constructions devraient fournir leur prestation de protection
pendant environ 40 ans.» Lentement mais sûrement, elles atteignent donc la fin de
leur durée de vie. Dans ce contexte, les autorités telles que l'Office grison
des forêts et des dangers naturels (AWN) ainsi que l'Office cantonal des ponts
et chaussées, mais aussi les entreprises ferroviaires comme les Chemins de fer
rhétiques (RhB), se voient confrontées à plusieurs questions. Que fait-on des
anciennes barrières en bois ? Les remplace-t-on par des ouvrages de protection
modernes mais certifiés ? Les entretient-on et si oui, comment ? Faut-il
remplacer tout le bois ou seulement une ou deux poutres ?
Le projet de recherche «Palissades en bois comme protection contre les chutes de pierres» de l'Institut pour la construction dans les régions alpines à la Haute école spécialisée des Grisons doit fournir les premières réponses à ces questions. En collaboration avec la chaire de construction en bois de l'Institut de statique et de construction (IBK) de l'EPFZ de Zurich, des essais de marteaux-pilons simulant des chutes de pierres permettent d'élaborer la base de connaissances pour le dimensionnement, la certification et le développement d'ouvrages de protection contre les chutes de pierres avec des éléments en bois. James Glover est le chef de projet de ce travail de recherche : «L'objectif général et à long terme est de pouvoir certifier les ouvrages de protection traditionnels en bois». Le secteur devrait ainsi disposer d'une alternative écologique à l'utilisation d'ouvrages de protection contre les chutes de pierres standard en filets d'acier.
Les essais dynamiques au marteau-pilon à l'EPFZ de Zurich en vidéo. (source : DR)
Les données sont collectées dans le cadre de
la recherche sur les chutes de pierres sur les poutres en bois. Pour cela, on
utilise d'une part des rondins de châtaignier fraîchement coupés, d'autre part
des poutres de même essence qui ont été utilisées pendant 30 ans dans une
ancienne construction de protection contre les chutes de pierres près de
Gruobenwald, à l'extérieur de Klosters. Cette construction a dû être démontée
après qu'une nouvelle évaluation des risques - déclenchée par l'abattage
inévitable d'arbres dans l'ancienne forêt de protection - a révélé un risque
accru de chutes de pierres. L'équipe de recherche a ainsi eu l'occasion
d'examiner les barrières en bois de plus près et de soumettre les matériaux qui
les composent à des tests de résistance. Mais comme le raconte le directeur de
recherche, cela s'est fait in extremis : «Elles ont failli en effet être éliminées».
Ce n'est que sur demande que James Glover a pu sauver les constructions. Les vieux bois
sont idéaux pour la recherche ; ils ont été exposés au vent et aux intempéries
pendant trois décennies. «La question est de savoir si leur capacité de
protection diminue ou non avec le temps.»
Dans le cadre du projet de recherche, les poutres en bois
sont soumises à deux essais. Dans le laboratoire de construction de la HES des
Grisons à Coire, les scientifiques effectuent des tests statiques: les
poutres sont montées en deux points dans le cadre d'un essai de flexion en
trois points et soumises lentement à une charge ponctuelle élevée au centre. «Cela correspond à l'application d'une charge ponctuelle que nous subissons lors
d'une chute de pierres.» La charge maximale est d'abord calculée sur la base
d'un tableau de construction technique et à l'aide du périmètre, de la longueur
et du poids d'une poutre. Ensuite, on teste combien de flexions et de charges le
bois peut réellement supporter jusqu'à ce qu'il se brise. James Glover : «Par
rapport à nos premières estimations, les anciennes poutres présentent souvent
une charge de rupture deux fois plus élevée». Outre l'application de la
charge, le processus de rupture est également analysé afin de pouvoir
documenter à la fin la résistance statique à la rupture et les mécanismes de
défaillance des poutres sous charge de choc.
A l'EPFZ de Zurich,
les choses se passent un peu plus violemment. «Ici, on simule en
fait une chute de pierres», explique le responsable de recherche. Cela prend la forme d'un marteau
de frappe de 3,5 t qui oscille de manière dynamique contre les poutres. Le
marteau est alors lâché d'une hauteur de 4 m et, comme une chute de
pierres, il frappe à grande vitesse et avec force le bois monté sous le
pendule. Sans obstacle, le marteau oscillerait comme un pendule. La différence
de hauteur lors de l'oscillation, qui résulte de l'impact, est documentée pour
la recherche. «Nous utilisons cette différence pour déterminer l'énergie
transmise aux poutres». Contrairement au test statique, la poutre est ici
traversée en deux parties.

Crédit image: Pascale Boschung
Essai statique à Coire: les poutres sont montées en deux points dans le cadre d'un essai de flexion en trois points et soumises lentement, étape par étape, à une charge ponctuelle élevée au centre.
La pierre a été scannée en 3D sur place et
l'environnement a été analysé afin de reconstruire la chute exacte du morceau.
Ensuite, nous sommes passés du terrain au laboratoire. En se basant sur les
points d'impact sur le terrain et sur les arbres, la distance de saut a été
déterminée et la vitesse de la pierre a été estimée sur cette base. «A partir
de là, nous avons calculé une vitesse d'environ 14 m par seconde lors de
l'impact avec une pierre de 800 kg.» Selon lui, on se situe ainsi
dans une fourchette de 100 kJ - ce qui correspond à une petite voiture
qui fonce dans un mur à environ 50 km/h sans être freinée. Mais la capacité de
protection des clôtures en bois est actuellement estimée à un niveau beaucoup
plus bas: dans un graphique de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) sur
les ouvrages de protection contre les dangers liés aux mouvements de masse, les
murs en bois sont classés dans la catégorie la plus basse, entre 30 et 50
kJ.
Or, c'est précisément
là que le projet de recherche intervient. Les données et les bases de
dimensionnement élaborées permettront à l'avenir de déterminer si le mode de
construction pourrait effectivement être utilisé dans une zone de chutes de
pierres de 100 kJ. Dans ce cas, de telles clôtures de protection en
bois deviendront une option pour les autorités. Cela mis à part, elles ne
pourront pas être utilisées partout, même après une certification. En effet,
les solutions en acier devraient continuer à avoir une longueur d'avance en
matière de protection contre les chutes de pierres: «Les derniers filets en
fil d'acier avec éléments de freinage peuvent désormais arrêter jusqu'à 12'500 kJ».
Mais pour James Glover, les domaines d'application possibles de
la méthode traditionnelle avec des éléments en bois seraient par exemple les
forêts qui offrent déjà en soi une protection efficace contre les dangers
naturels tels que les avalanches, les chutes de pierres, les glissements de
terrain et les coulées de boue.
Alternative durable
La méthode de construction traditionnelle avec des éléments en bois serait
également une alternative durable. En effet, les ouvrages de protection contre
les chutes de pierres en acier présentent une empreinte carbone comparativement
élevée et sont en outre protégés contre la corrosion par des revêtements en zinc
nocifs pour l'environnement. «La durabilité est un thème croissant dans le
secteur de la construction», explique James Glover. De plus, l'Office des forêts et
des dangers naturels ainsi que l'Office des travaux publics et les RhB ont
manifesté leur intérêt pour le projet. Outre la durabilité, la construction
traditionnelle pourrait également présenter des avantages économiques. En
Suisse, on investit relativement beaucoup d'argent dans la protection contre
les dangers naturels. Mais ce n'est pas le cas pour les routes
internationales qui traversent des régions montagneuses comme au Népal, dans
l'Himalaya, en Afghanistan ou au Tadjikistan. Dans ce contexte, les
palissades en bois pourraient constituer une variante avantageuse.

Crédit image: DR
Les points d'impact sur le terrain et sur les arbres ont permis d'estimer la distance de saut et, par conséquent, la vitesse du gros rocher près de la palissade en bois dans la forêt de Sela.
Mais le chemin à parcourir pour y parvenir est encore long. Il s'agit tout d'abord d'élaborer un guide de dimensionnement des palissades en bois. L'équipe de recherche s'est fixé d'autres objectifs pour l'avenir, notamment l'élaboration d'un guide pour le contrôle et l'entretien des palissades en bois existantes ou l'amélioration de la construction rigide. Mais aussi un renforcement des constructions - par exemple par l'introduction d'éléments de freinage, de manchons articulés ou d'un filet de précontrainte. Et l'objectif à long terme est bien sûr le développement d'une procédure de certification.
(Pascale Boschung).
Participants au projet
Institut für Bauen im alpinen Raum (IBAR), HES Grisons
Direction du projet :
James Glover
Equipe : Yasin Akkus,
Philip Crivelli, Imad Lifa, Dionysios Stathas
Ecole polytechnique
fédérale de Zurich :
Chaire de
construction en bois
Institut de statique
et de construction (IBK), EPF Zurich
Recherche expérimentale (expRES@IBK)
Alex Sixie Cao